Vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et améliorer votre expérience. Vous pouvez accepter tous les cookies ou gérer vos préférences
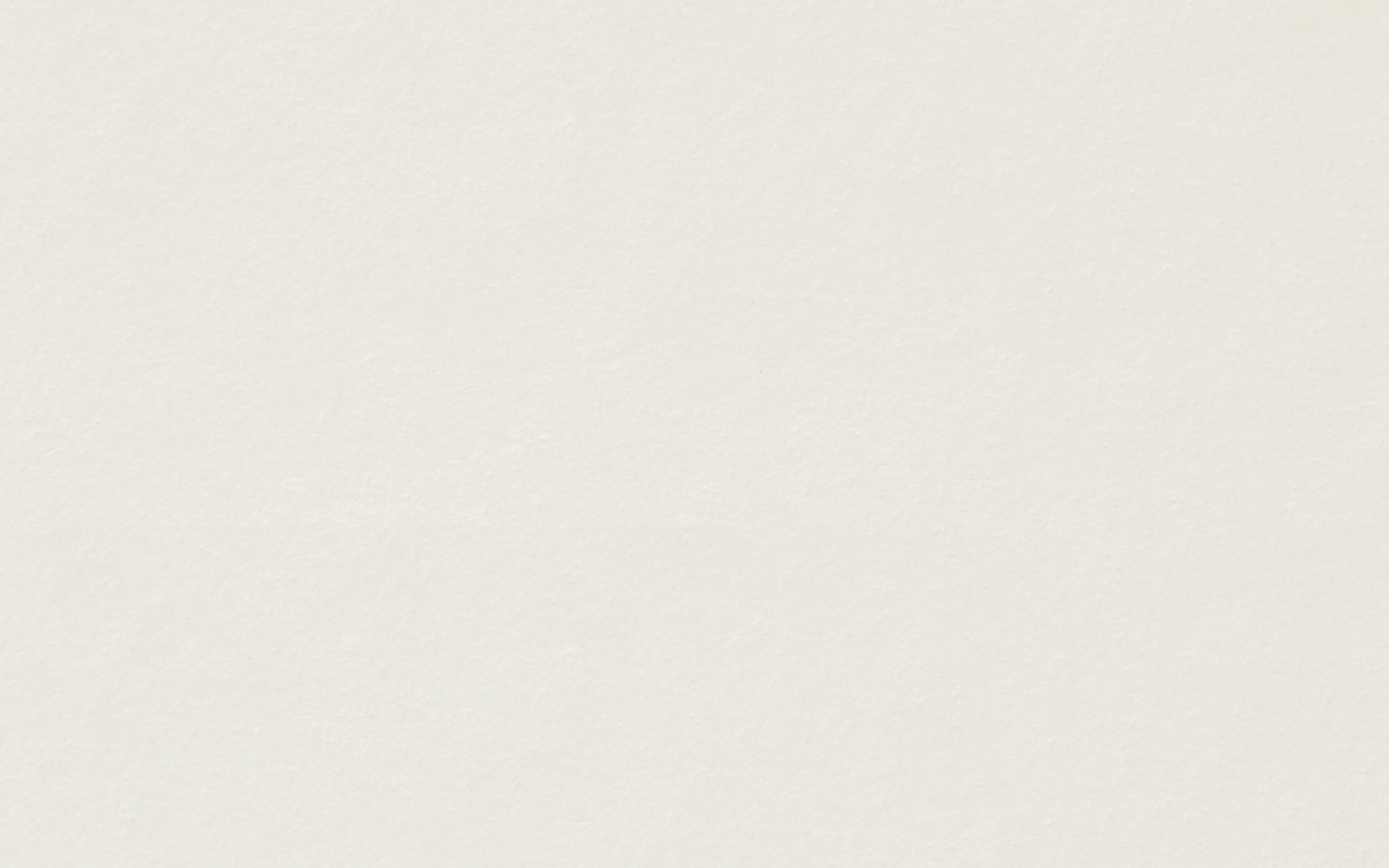

En bordelais, sur la rive droite des fleuves Garonne et Dordogne, non loin du Périgord, plusieurs appellations renommées ((Pomerol, Fronsac, Canon-Fronsac, Lalande-de-Pomerol, Saint-Emilion) et les appellations communales accolant à leur nom de village celui de Saint-Emilion), forment le vignoble du libournais du nom de la bastide de Libourne sise à la confluence du fleuve Dordogne et de la rivière Isle.
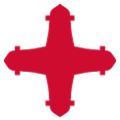

A l’opposé des grandes propriétés médocaines, le Libournais est le territoire d’une image presque bourguignonne de petites exploitations viticoles familiales. Pomerol est sur cette zone géographique l’une des appellations d’origine protégée les plus petites (813 hectares) et les plus morcelées (138 vignerons).
Elle occupe un terroir unique, une colline d’argile bleue veinée d’oxyde de fer rouge datant de l’ère tertiaire recouverte de graves rubéfiées du quaternaire, quartzite et silex, parmi lesquels les travaux viticoles mettent parfois à jour des outils paléolithiques ou néolithiques, taillés ou polis, premières traces d’une occupation humaine de cette colline.
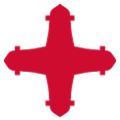

L’appellation Pomerol forme un triangle bordé au nord-est par le ruisseau Barbanne, au sud-est par la commune et l’appellation Saint-Emilion dans la région des graves des Châteaux Cheval-Blanc et Figeac et à l’ouest par la ville de Libourne.
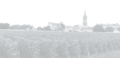

La Barbanne, affluent de la rive gauche de la rivière Isle, ancienne frontière linguistique entre le gascon à Pomerol et le patois saintongeais au nord a donné son nom, à l’époque médiévale, à l’ensemble de l’aire actuelle d’appellation. Celle-ci est ainsi désignée dans un cartulaire des archives du grand prieuré de Toulouse de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean- de-Jérusalem sous le nom de « Terres de Barbanne ».
La frontière sud-est, bordant la juridiction de Saint-Emilion, fût probablement une voie antique menant au port de Condat à la confluence de la rivière Isle et du fleuve Dordogne. Les villas viticoles et de polycultures gallo-romaines de la région avaient ainsi via le plateau de Pomerol un accès fluvial.
L’hypothèse de la présence sur la commune de Montagne, quelques kilomètres à l’est de Pomerol, de Lucaniac, villa du célèbre poète et consul Ausone est crédible. Diane et Vénus, statuettes datant de la fin du IVe siècle et début du Vème siècle, conservées au musée d’Aquitaine et au musée du Louvre furent découvertes en ce lieu en 1843.
À l’ouest s’étend la bastide de Libourne dont Pomerol est le vignoble historique. Elle fût fondée en 1270 par Sir Roger de Leyburn, Lieutenant du Roi d’Angleterre Henri III, sur le site de l’ancien port gallo-romain de Condatis (Condat).
C’est le début d’une histoire de plus de six siècles entre Pomerol et l’ordre Hospitalier. Quelques bornes crucifères marquant les frontières de la Commanderie et la Croix de Gay, croix de carrefour du XIIe siècle sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, sont les témoins actuels de l’ancienne possession hospitalière à laquelle la révolution française mis fin en 1792.
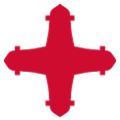
A l’époque moderne la reconnaissance de la qualité exceptionnelle des vins de Pomerol ne débute qu’à la moitié du XIXème siècle. La prééminence actuelle du cépage merlot sur l’appellation (80% de l’encépagement) rend séduisant d’unir les destinés de ce cépage et de ce terroir.
Fils du cabernet franc le cépage merlot a longtemps été orphelin de mère, jusqu’à la découverte en 1992, en Bretagne, dans la vallée de la Rance sur la commune de Saint-Suliac proche du lieu-dit anse du Vigneux d’une variété inconnue de vigne cultivée, postérieurement baptisée Magdeleine Noire des Charentes.
Mûr à la Sainte Marie Madeleine (22 juillet) ce cépage, a probablement, entre autres qualités, conféré au merlot une maturité plus précoce que celle du cabernet franc et peut être aussi des saveurs particulières qui en font le préféré d’un oiseau à la couleur de plumage proche d’une baie de merlot à maturité, le merle noir.
Ce n’est que dans la seconde moitié du XIXème siècle que le merlot s’installe majoritairement à Pomerol supplantant d’autres cépages. L’une des hypothèses est la modification du comportement agronomique des cépages induit par le nécessaire greffage de ceux-ci sur porte-greffes américains suite à la crise du phylloxéra qui débute en France en 1853.
Il est possible que le merlot, plus que tout autre cépage bordelais, ait tiré bénéfice de ce greffage qui aurait régularisé sa production en diminuant sa sensibilité au phénomène de coulure (perte d’une partie de la récolte au moment de la nouaison (formation des baies) par mauvaise fécondation des fleurs de vignes).
L’export des vins des rives droites de la Garonne et de la Dordogne, de la région du libournais, dont fait partie Pomerol, est facilité par la construction des « ponts de pierre » (sur la Garonne à Bordeaux entre 1810 et 1822 et sur la Dordogne à Libourne entre 1820 et 1824) puis par l’arrivée de la voie de chemin de fer Bordeaux-Libourne en 1851 qui supplante progressivement l’expédition des vins par le fleuve sur les traditionnelles gabarres.
Cette rive droite des fleuves girondins devient alors plus accessible.
La mise en lumière de la qualité exceptionnelle des productions souvent confidentielles de Pomerol et Saint-Emilion devient possible. Courtiers et négociants en vins de la « place de Bordeaux », interlocuteurs traditionnels des Crus Classés du Médoc commencent à s’intéresser aux grands vins du Libournais.
D’autres négociants, pour beaucoup originaire du département de la Corrèze, s’installent à Libourne et participent à la notoriété du vignoble sur le territoire et au-delà.
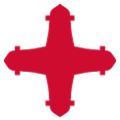
Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et améliorer votre expérience. Vous pouvez accepter tous les cookies ou gérer vos préférences